| _____ |
RÉSENTATION
Pour présenter cette brochure, c'est-à-dire pour en justifier
la publication, je voudrais souligner un mot inscrit sur la page de garde
: reportage.
Pour dire bien clairement que mon étude n'a pas la moindre
prétention d'ordre scientique. Je sais qu'elle est incomplète.
Je sais qu'elle ne "couvre" pas le problème. Ce n'est pas une
enquête véritable au sens que les travailleurs sociaux donnent
à ce terme.
C'est un reportage, rien de plus. Mais si j'accepte qu'il prenne la
forme d'une brochure, c'est dans l'espoir que ces quelques pages et les faits
qu'elles contiennent, tous rigoureusement contrôlés, inspirent
aux hommes de science le travail complet, scientifique, exhaustif dont nous
avons le plus pressant besoin.
G. P.
I
LES CAUSES
UN PROBLÈME DE CONSCIENCE
Le sort de 12,000 enfants -- Des personnes humaines
Lumière sur des faits -- Nous sommes responsables
Le reporter qui trace ces lignes vient de passer deux mois au pays glacé
de l'enfance malheureuse. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas
suffisamment le métier de journaliste, quelques mots d'explication.
Quand un journal lance sur une nouvelle piste son préposé aux
enquêtes sociales, ce dernier ne connaît presque rien du sujet
qu'il va traiter. Il se met en route avec, pour tout bagage, un carnet
propre et quelques points d'interrogation. Mais le reporter sait bien
ce qu'il veut: découvrir les faits, tous les faits. Éclairer
dans son ensemble une situation généralement complexe, faire
voir la réalité telle qu'elle est, après l'avoir
débarrassée de toutes les versions officielles et de tous les
commentaires tendancieux.
Or, comme le reporter part de zéro, il doit aborder tour à
tour et les versions officielles et la réalité. Pour ce
faire, deux méthodes s'offrent à lui.
BUREAUX
La première consiste à pénétrer dans son sujet
par la porte de tout le monde, celle du rez-de-chaussée. Alors,
le commentaire viendra le premier, la réalité ensuite. Le
reporter devra faire antichambre. Il rencontrera des personnages officiels,
des fonctionnaires, des professionnels de la question. Il écoutera
la version de ceux qui chaque jour s'occupent du problème et qui en
portent la responsabilité directe. Et quand il parviendra enfin
dans les étages et le sous-sol du sujet, quand Il accédera
à la réalité elle-même, il devra comparer les
faits avec les commentaires qu'il vient d'entendre.
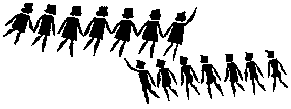
C'est une méthode. Mais ce préambule a justement pour
but d'expliquer que la mienne est différente.
Pour m'initier aux problèmes de l'enfance en soutien, l'ai voulu
procéder dans l'ordre inverse: voir d'abord le problème, prendre
connaissance des faits brutaux, puis comparer mes conclusions spontanées,
mes réactions de profane, avec les solutions qu'on applique couramment.
Je ne prêche pas cette méthode comme une théorie
d'application universelle. Il n'est pas toujours possible de percer
dès le premier jour le mur des statistiques. Mais dans le cas
des petits sans famille, n'importe qui peut explorer leur domaine et
connaître leur condition, pourvu qu'il y mette le temps et l'attention
nécessaires.
Pour ma part, je suis entré tout de go dans une demi-douzaine de
crèches et d'orphelinats. J'ai pris contact avec les
enfants. Je les ai suivis à travers leurs maisons; je les ai
écoutés quand ils avaient l'âge de parler. Je suis
entré dans leurs classes, dans leurs dortoirs; j'ai fureté
à travers les maisons froides et les visages tristes.
En quelques jours, j'avais acquis la conviction de toucher là l'un
des problèmes les plus tragiques de notre société et
l'un des moins connus.
CONSCIENCE
Quand je dis problème, je n'entends pas ici restreindre ce terme à
son sens technique. Tout est "problème", de nos jours, depuis
la bouteille de lait (ronde ou carrée?) jusqu'à la croyance
en Dieu.
Mais je parle en ce moment d'un problème social et celui de l'enfance
en soutien a toute l'ampleur des grands drames humains.
D'abord par le nombre des personnes humaines concernées. Sait-on
seulement que dans notre seule province, l'État (donc, nous tous)
a la charge directe de milliers d'enfants mineurs? L'orphelinat du coin
de la rue, et dont la masse de brique jaune vous est devenue familière,
ne représente qu'une fraction du problème. Si l'on
réunissait un jour (mais Dieu nous en garde !) en un seul lieu tous
les enfants sans soutien de la province, on pourrait en faire une ville de
12,000 habitants.
Et ce facteur quantitatif n'est évidemment pas le seul qu'il faille
considérer. Le problème de l'enfance malheureuse, c'est
le problème de milliers de personnes humaines que la société
doit prendre à sa charge. Et ces personnes humaines, c'est leur
destin tout entier qui se trouve en jeu puisque la société
doit leur fournir appui au moment crucial de leur existence, cette enfance
décisive au cours de laquelle s'amorce toute la vie.
Il serait trop facile de s'en tirer avec des statistiques et de croire le
problème réglé parce que les subsides gouvernementaux
ont sensiblement augmenté depuis des années. La
réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus délicate
et fragile qu'un vote à l'Assemblée législative.
Le public peut bien faire confiance aveugle à une administration quand
il s'agit de construire une route, encore que cette confiance lui coûte
parfois fort cher. Mais quand la société, disons mieux la
communauté, confie au gouvernement et à quelques
congrégations religieuses le sort de milliers d'enfants, de tout petits
sans ressources, nous n'avons pas le droit de considérer notre devoir
rempli une fois que nous avons payé nos impôts.
Le problème de l'enfance en soutien, c'est en fait un problème
de conscience.
SURSAUTS
L'histoire récente en notre province le prouve abondamment. A
plusieurs reprises, au cours des derniers dix ans, le public a dressé
l'oreille, comme un homme qui dort mal sur un problème mal
réglé. Il suffirait de rappeler ici les incidents de Lorette,
l'enquête Garneau et plus récemment le cri d'alarme du
Mont-Saint-Antoine qui ne recevait plus de quoi nourrir ses pensionnaires
convenablement...
Or, chaque fois que s'est éveillée la curiosité publique,
un progrès très net a été enregistré,
comme nous le verrons plus loin. Mais d'autre part, chaque fois aussi,
notre littérature s'est enrichie de certains débats subjectifs
assez stériles et de plusieurs ouvrages dont quelques-uns frisent
la bêtise et la mauvaise foi.
Pourquoi ces débats n'ont-ils généralement rien
avancé, ou, disons mieux, n'ont-ils pas provoqué les quelques
pas décisifs qui se font encore attendre ? Tout bonnement parce qu'un
problème de conscience provoque des réactions extrêmes
et que le débat a toujours dévié sur la défense
et l'illustration de nos institutions, de nos communautés religieuses,
au lieu d'éclairer le problème profond des enfants.
NOS BUTS
Dans cette perspective, il est donc très important de clarifier dès
aujourd'hui nos positions dans cette enquête, i.e. les buts que nous
poursuivons par la publication de nos articles.
Ranimer un débat ? Point du tout. Père de famille, nous
savons très bien qu'il est néfaste de se quereIler sur le sort
des enfants. Néfaste et stérile. Mais nous croyons
par ailleurs que tous les citoyens participent, vis-à-vis l'enfance
en soutien, d'une responsabilité qui n'est pas étrangère
à la paternité elle-même. Ce n'est pas en journaliste
que nous envisagerons ce problème, mais en père de
famille. Toute autre attitude nous paraitrait faillir à la
charité, la vraie, celle qui ne tend pas l'aurnône au bout du
bras.
S'agira-t-il d'attaquer celui-ci, d'incriminer celui-là, de partager
les fautes et d'attirer sur les têtes des châtiments? Cela
non plus ne nous intéresse pas, trop persuadés nous-mêmes
que la responsabilité s'étale sur toute la société
et que personne n'a le droit de s'y dérober.
Voulons-nous donc prêcher un système ? Nous engageons-nous
dans cette étude avec des pensées derrière la
tête? Tout au contraire. Nous avons abordé franchement
le sujet, sans aucun préjugé. Et nous espérons
faire voir clairement, quand viendra le moment de conclure, que nos convictions
acquises l'ont été à la seule lumière des faits
et de la plus élémentaire raison.
Qu'on n'aille donc pas nous supposer des intentions obscures.
Utiliser le sort des enfants pour attaquer un gouvernement nous
apparaîtrait comme un acte odieux.
Disserter sur leurs misères pour satisfaire des préjugés
de sociologue amateur ne vaudrait guère mieux. Nous n'avons donc
qu'une seule pensée: faire connaître les joies et les misères
de milliers d'enfants dont nous sommes tous responsables, afin que
s'améliore leur condition.
Nous ne demandons donc au lecteur, outre son attention de quelques minutes
quotidiennes, qu'une chose : cette confiance élémentaire qui
permet le travail efficace et le crédit de notre sincérité.
À LA SOURCE DU MAL
Chaque année, plus de 3,000 naissances illégitimes --
Ceux qu'on n'adopte pas -- Qu'est-ce qu'un orphelin ? --
Les questions qui se posent
Quand j'ai cité hier ce chiffre de 12,000 enfants, le lecteur s'est
sûrement posé une question : "D'où viennent-ils, au juste
?" Et pour bien situer le problème, il importe en effet d'en
déterminer la source, le plus exactement qu'il est possible.
Sans doute le grand public a-t-il des notions générales sur
le problème de l'enfance en soutien. Il sait par exemple que
les enfants dits illégitimes en fournissent un contingent et les orphelins
le reste. Mais tout cela est assez vague et quelques chiffres mettront les
choses en place.
SANS PARENTS
Il est impossible d'évaluer avec précision le nombre d'enfants
illégitimes qui naissent chaque année dans notre province. Il
est plus difficile encore d'établir, même en gros, le lieu d'origine
des parents. Cela s'explique facilement, dès qu'on y
réfléchit: la fille-mère recherche l'anonymat. Quand
vient la fin de la grossesse, le moment de mettre son enfant au monde, elle
quitte presque invariablement son milieu et se réfugie dans une grande
ville, soit principalement à Montréal et à
Québec.
Notons en passant que le nombre des naissances illégitimes dans ces
deux centres n'implique évidemment pas grand'chose quant aux moeurs
des populations urbaines, comme on le laisse croire dans certains
ouvrages. Les villes ont à ce chapitre des statistiques fort
exagérées, du fait même qu'elles recueillent de partout
les filles-mères en quête d'anonymat.
Quant aux naissances illégitimes enregistrées comme telles,
le service fédéral de la démographie nous révèle
les chiffres suivants. Au cours des cinq années qui se sont
écoulées entre 1943 et 1949 (les statistiques de cette
dernière année ne sont pas encore publiées), on a
enregistré dans la province de Québec les nombres suivants
de naissances illégitimes
1944 3,098
1945 3,058
1946 3,630
1947 3,712
1948 3,792
DES MILLIERS
Qu'advient-il chaque année de ces trois mille enfants (bientôt
quatre mille) que la société reçoit presque tous en
tutelle ? La grande majorité trouvent bientôt un foyer d'adoption
et, du même coup, la chance d'une vie normale. Mais comme nous
n'avons pas l'intention d'examiner tout de suite le problème de
l'adoption, ce sont les autres enfants qui nous préoccupent, les
quelques centaines de tout petits sans famille qui se trouvent laissés
pour compte dans l'institution qui les avait recueillis.
Ceux-là s'engagent dans une filière d'institutions diverses
d'où ils ne sortiront qu'à 16 ou 18 ans pour tenter
l'aventure dans le monde des hommes normaux...
Pourquoi l'adoption n'a pas résolu leur problème ? Nous trouvons
à cela tout un jeu de raisons complexes et dont j'aligne ici les
principales.
10 Il peut s'agir d'enfants malades,
handicapés de quelque manière et à cause de cela impropres
à l'adoption. C'est le cas de presque toutes les petites filles
qui restent en institution puisque, en matière d'adoption, la demande
dépasse l'offre quand il s'agit de filles.
20 Pour les garçons,
au contraire, plusieurs, chaque année, restent sur le carreau. Et
pour des raisons que nous analyserons plus loin, chaque mois qui s'ajoute
à leur âge diminue d'autant leurs chances de trouver un
foyer. Ils atteignent vers 3 ans le point mort et tous les
intéressés s'accordent à dire qu'on retrouvera encore
dans l'institution, seize ans plus tard, les petits malheureux qui y
célèbrent leur troisième anniversaire. Voici donc une
proportion d'enfants illégitimes, sains de corps et d'esprit, qui
grandiront dans les maisons communes de l'enfance en soutien.
30 Enfin, il reste les enfants, garçons
et filles, qui ne peuvent pas être placés en adoption parce
que les filles-mères n'ont pas renoncé à leur droit
maternel. On sait que la loi du Québec ne permet pas aux
sociétés d'adoption de placer un enfant sans le consentement
de la mère. Cela semble normal au premier coup d'oeil mais donne
lieu, dans de très nombreux cas, à de véritables drames.
La fille-mère porte à son enfant un intérêt souvent
sentimental. Elle le laisse en institution. Elle refuse de céder
ses droits. Il suffit qu'elle fasse parvenir à la crèche
une carte postale, de six mois en six mois, pour qu'au terme de la loi l'enfant
soit intouchable.
Il vieillit, grandit; on le refuse aux parents adoptifs qui le remarquent
et le demandent. Il franchit l'étape fatale de la troisième
année; il est désormais impropre à l'adoption... et
la fille-mère l'oublie. Le petit restera toute sa vie sans famille,
seulement parce que la loi ne distingue pas, n'admet pas la tutelle, et fait
à la fille-mère une confiance sans conditions.
"ORPHELINS"
Précisons tout de suite que la grande majorité des pupilles
de l'État n'est pas composée d'enfants illégitimes mais
au contraire d'enfants séparés de leurs familles pour diverses
raisons et qu'on désigne sous le nom d'"orphelins". Mais le
terme ne doit pas être pris dans le sens précis qu'on lit au
dictionnaire.
On serait surpris de compter dans chaque "orphelinat" les enfants
légitimes dont les parents sont bien vivants ! Ils forment
généralement la majorité.
Ce qu'on appelle "orphelinat" est en fait une maison pour enfants de foyers
pauvres ou divisés. Le nombre est effarant des familles
miséreuses qui trouvent dans l'éloignement de leurs petits
la solution à leurs difficultés économiques. Nous
verrons dans quelques jours comment certains services sociaux contournent
la difficulté et parviennent à secourir les familles sans les
diviser, mais il reste, hélas! de nombreux cas où l'"orphelinat"
constitue la seule solution pratique...
De plus, l'orphelinat recueille les enfants de parents qui vivent et qui
travaillent mais que le désaccord conjugal a séparés
l'un de l'autre. Ceux-là encore forment un contingent plus fort
que celui des véritables orphelins. De ce dernier nombre, il
y a les orphelins de mère, que le papa ne peut plus garder parce qu'il
a "cassé maison" à la mort de sa femme. Il y a les orphelins
de père dont la mère veuve ne peut évidemment pas vivre
à même nos scandaleuses pensions des mères
nécessiteuses dont nous montrerons plus loin la sinistre-bêtise.
Et enfin, faible majorité, les "grands orphelins", ceux dont père
et mère sont décédés et qui n'ont trouvé
refuge chez aucun parent plus éloigné.
PROPORTIONS
La proportion exacte de ces divers groupes ? Je n'ai pu trouver nulle
part de compilation exacte quant aux nombres globaux. Mais à
titre d'exemple, je citerai le cas d'un petit orphelinat rural. Sur
72 pensionnaires, 50 environ viennent de foyers divisés, une quinzaine
de foyers sans père ou sans mère, à peine 6 ou 7 de
foyers sans parents.
Et je ne serais pas surpris d'apprendre, si jamais on nous donne des compilations
complètes, que les mêmes proportions s'appliquent à
l'ensemble des quelque sept mille enfants qui vivent dans les orphelinats
et qui sont tous nés de parents légitimes.
Quoi qu'il en soit, tel est le problème.
Des crèches et des foyers en panne, des centaines d'enfants continuent
d'affluer vers les institutions diverses qui leur sont
réservées. Chaque année, le nombre
augmente. Chaque année, de nouvelles maisons s'édifient.
Or, nous posons devant ces milfiers d'enfants la question qui intéresse
tout le monde, et en premier lieu notre conscience: quel sort est
réservé à ces personnes humaines? Quelle condition
de vie leur est faite et quelle chance leur est donnée de réparer
avant l'âge adulte l'accident du destin qui en fait des
déclassés ?
UN MARCHÉ NOIR DES ENFANTS?
Pourquoi il est possible --- Comment il se pratique ---
Exceptions? --- Il nous manque des témoins
Existe-t-il dans notre province un marché noir des bébés
? Autant dire notre avis sur cette question, puisqu'elle se pose, avant d'aborder
le problème de la fille-mère.
Car on se souvient que l'été dernier, un rapport publié
par une assistante sociale d'Ottawa avait créé dans notre presse
un incident considérable. L'accusation était de taille
puisque nos sociétés d'adoption ont senti le besoin de protester
publiquement et de nier point par point toutes les implications du rapport
en question. On accusait le Québec de vendre des nourrissons
sur le marché noir à certains clients américains.
Quant aux profanes, on peut dire qu'ils n'y ont rien compris. Et nous
admettrons volontiers qu'au premier coup d'oeil les affirmations de Mlle
Burnes semblaient bien dénuées de toute vraisemblance.
PLAUSIBLE
Existait-il vraiment des ménages disposés à payer un
enfant quand on nous chante sur tous les toits que les crèches sont
remplies de bébés, quand les sociétés d'adoption
prêchent dans nos églises sur le dénuement des tout-petits
qui tendent les bras en vain? Comment donc le marché noir pouvait-il
subsister dans ce domaine où, selon toute apparence, l'offre dépasse
continuellement la demande ?
Il faut cependant y regarder de plus près. Et si cette accusation
a fait dresser l'oreille aux spécialistes, c'est qu'en dépit
de son aspect loufoque elle était fondée sur des faits réels
et bien connus des personnes qui s'intéressent à l'enfance
malheureuse.
Rappelons d'abord un fait que nous signalions déjà dans notre
article d'hier: le nombre considérable de ménages qui demandent
à adopter des filles. Tandis que des centaines de garçons
grandissent dans les institutions, on ne trouve pas assez de petites filles
pour satisfaire à toutes les demandes.
Mais il y a plus. Le rapport de Mlle Burnes visait un prétendu
commerce international. A l'en croire, c'étaient des parents
américains qui, moyennant finance, venaient chercher ici des enfants
qu'ils emportaient ensuite chez eux au mépris de toute loi. Et
loin d'augmenter la vraisemblance de l'accusation, cette note cosmopolite
la rendait, aux yeux du profane, moins plausible encore.
Pourtant, les spécialistes de la question s'y reconnaissaient, eux,
de mieux en mieux. Car ils savent que les exigences des sociétés
d'adoption aux Etats-Unis dépassent de beaucoup en
sévérité celles des sociétés correspondantes
dans notre province. Pour obtenir un enfant en adoption, le ménage
américain doit passer par une série de tests, d'examens,
d'entrevues et d'enquêtes qui durent plusieurs mois. Nos voisins
ne manquent certes pas d'enfants illégitimes qui cherchent un foyer,
mais les Américains insistent très fort sur les qualités
de ce foyer. Ils poussent très loin les précautions; ils
font l'impossible pour que chaque adoption soit un succès, et un
succès permanent.
Le moment n'est pas venu de juger s'ils ont tort ou raison, ni de comparer
leurs méthodes aux nôtres. Notons seulement le fait. Il
explique assez bien que des ménages d'outre-frontière, en
quête d'une adoption facile, viennent tenter ici leur chance. Ils
peuvent le faire en conformité avec notre loi et déjà
cela représente pour eux un avantage sensible. On sait en effet
que la loi québécoise permet l'adoption légale après
une période d'essai de six mois seulement, alors qu'aux Etats-Unis
les délais sont beaucoup plus longs et se chiffrent en années.
Mais ils peuvent aussi le faire illégalement, au mépris de
nos lois et des leurs, et c'est alors qu'on peut vraiment parler d'un
marché noir des bébés.
UN EXEMPLE
Ce dernier existe-t-il ? Ma réponse sera très prudente mais
nettement affirmative.
Elle sera prudente pour une raison très simple. C'est qu'en cette
matière, les témoins se défilent invariablement dès
que le débat devient public. Ces témoins, qui sont-ils
en effet ? Les filles-mères elles-mêmes, les seules, avec le
médecin marron et les Américains complices, à
connaître la vérité sur la naissance de leur
enfant. Sur la foi de quelques témoignages, soigneusement
vérifiés, je puis bien affirmer que le marché noir se
pratique. Mais de là à citer des cas précis, à
donner des noms, des lieux et des dates, il y a toute la marge entre une
certitude privée et une preuve légale...
Un exemple fera mieux comprendre la situation du reporter en pareille
matière.
Une fille-mère me raconte comment elle a mis au monde un enfant à
l'hôpital privé du Dr Z. Elle avait choisi celui-là parce
que le Dr Z avait la réputation de "placer" les enfants dans des familles
très riches et d'une façon absolument anonyme, inconnue de
tous, y compris des sociétés d'adoption elles-mêmes.
Cet anonymat coûtait fort cher: grosse somme au médecin (nous
verrons comment les filles-mères sont parfois exploitées) pour
l'accouchement et l'hospitalisation et grosse somme pour le "placement" dont
on avait la garantie qu'il assurait au petit un avenir de richard
américain...
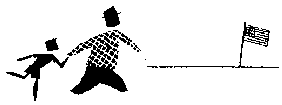
La jeune fille s'est donc rendue à l'hôpital après un
long séjour anonyme dans une famille modeste de la
métropole. Pendant son séjour dans cette institution
privée, elle n'a eu connaissance de rien mais elle s'est liée
d'amitié avec une garde-malade qui lui apprendra plus tard ce qui
s'est passé.
COMMERCE
Dès l'annonce d'une naissance, le médecin s'était
abouché avec un "client" des États-Unis. Moyennant forte
somme, ce dernier devait "séjourner" à Montréal, longuement,
autour de la date probable, avec son épouse. Puis, le moment
venu, on avait falsifié un certificat de naissance. Le
nouveau-né devenait le fils légitime du ménage
américain qui repassait la frontière avec lui quelques semaines
plus tard. Ni vu ni connu !
Or, cette histoire se répète, à quelques détails
près, dans plusieurs cas. Les témoins ne sont pas toujours
les mêmes. Le sangfroid des responsables de l'hôpital confine
parfois au sans-gêne et les faits sont encore plus patents. Il
est donc incontestable que ces pratiques ont cours.
Mais comment le prouver ? Est-ce la fille-mère qui va témoigner
devant les tribunaux et dévoiler de la sorte un secret qui lui a
coûté plusieurs centaines de dollars ? Est-ce
l'infirmière? Elle aussi devrait alors révéler
le nom de la mère véritable et s'attirer des ennuis sans fin;
pour quel profit. La pratique paraît d'ailleurs assez anodine aux yeux
de gens distraits. Et si j'affirme sans hésitation qu'elle a
cours, je crois aussi qu'elle est assez peu répandue. Les
quelques cas que j'ai relevés ne sont probablement que des
exceptions. Et avant de conduire dans ce domaine des recherches fatalement
longues et difficiles, mieux vaudrait s'attaquer à des pratiques autrement
criminelles comme par exemple l'avortement. Mieux vaudrait aussi mettre
à jour l'exploitation éhontée de la mère par
certains hôpitaux privés, exploitation beaucoup plus courante.
PAS UNE FABLE
Le marché noir des bébés n'est pas une fable. C'est
cela surtout que je voulais tirer au clair. Mais je ne puis affirmer
qu'il se pratique sur une haute échelle. Et dans cette mer de
problèmes que constitue l'enfance en soutien, il ne mérite
certainement pas de retenir le meilleur de notre attention.
On peut souhaiter, certes, que les travailleurs sociaux et tous les
médecins honnêtes, toutes les infirmières intègres,
gardent l'oeil ouvert. Faire commerce de vies humaines reste une
transaction particulièrement odieuse et qui mérite d'être
traquée jusqu'en ses derniers repaires. Mais puisque le journaliste
reste impuissant à déterminer des nombres, à formuler
des accusations précises, mieux vaut nous appliquer à l'examen
d'autres faits plus patents et non moins troublants pour nos consciences
d'hommes libres.
"PLAÇONS BÉBÉS"
Hôpital à deux portes --- Pour l'amour du silence
---
Fausses représentations --- Une formule à trouver
"Hôpital X, maternité privée. Toute
discrétion. Plaçons bébé." En moins de dix
mots, ce petit texte publicitaire résume admirablement le drame de
la fille-mère. On n'a qu'à réfléchir un
instant sur chacun des quatre item qu'il contient : tout le problème
est là.
Mais auparavant, pour dissiper les malentendus, disons que cet article ne
vise pas tous les hôpitaux privés dont certains sont sans doute
très bien administrés. Malheureusement, il est impossible
de donner à tous les établissements du genre la même
absolution générale. Un manque de surveillance efficace,
l'octroi de permis sur simple visite des lieux et vérification des
titres du personnel, d'autres négligences encore font de plusieurs
hôpitaux privés des antres d'exploitation éhontée,
de transactions odieuses
.
Mais revenons désormais à notre texte publicitaire et
réfléchissons ensemble sur les deux premiers item : "Hôpital
X, maternité privée".
La première question qui se pose à l'esprit est la suivante:
"pourquoi les filles-mères vont-elles se faire exploiter dans ces
établissements louches quand il en existe d'officiels qui se
spécialisent dans l'accueil de tels cas ?"
UNE OBSESSION
La réponse est simple: c'est que la fille-mère est
obsédée par le problème de l'anonymat et qu'elle redoute
justement les maisons "officiellement spécialisées en cette
matière".
Je n'entreprendrai pas ici de décrire l'état d'âme de
la jeune fille qui attend un enfant. Ce serait peine inutile puisque
le lecteur n'a aucune difficulté à l'imaginer. Même
si nos moeurs évoluent rapidement, depuis quelques années,
vers plus de compréhension charitable, il reste que la fille-mère
est encore aujourd'hui un objet d'horreur pour tout le monde et surtout pour
ses proches. Il n'est question que de la "honte de la famille" et,
l'état de grossesse aidant, il arrive que les malheureuses tombent
dans des dépressions qui confinent à la maladie mentale.
Or, c'est dans cet état d'esprit que la jeune fille enceinte doit
aborder le difficile problème d'un accouchement secret et d'un
séjour à l'étranger suffisamment long pour détourner
les curiosités indiscrètes.
Dans la plupart des cas, non seulement la fille-mère doit porter
l'opprobre de son entourage mais elle finit par se croire elle-même
la dernière des criminelles. Elle finit par s'accuser de tous
les péchés d'Israël, à douter de son avenir, à
s'ancrer dans le déshonneur. Et nos institutions, disons-le,
images de nos préjugés, semblent confirmer à plaisir
cette idée fausse.
ENTRÉE DES FILLES-MÊRES
Pour s'en convaincre, votre reporter s'est présenté
lui-même dans un hôpital de cette province. Il s'est donné
pour le monsieur qui cherche à placer une amie mal en point mais qui
est disposé à tout payer. Savez-vous ce qu'on lui a répondu
? Qu'il se trompait de porte, qu'on n'admettait là que les femmes
mariées, que les filles-mères étaient reçues
par une porte différente et logées dans une aile à part.
Puis, sur l'insistance du monsieur, on lui a expliqué qu'aucune
épouse légitime n'accepterait de loger à la même
enseigne que les filles-mères, encore moins de partager leurs salles
ou leurs chambres. Est-ce la faute de l'hôpital ? J'hésite
à répondre. On rencontre aux États-Unis des
collèges catholiques qui n'admettent pas les Noirs, non certes parce
qu'ils les méprisent, mais parce que les parents blancs ne
"toléreraient pas" le compagnonnage de leurs rejetons avec des
étudiants de couleur. Les deux cas se ressemblent étrangement.
Et ainsi, par le rejet constant de la fille-mère, on conduit parfois
cette dernière au bord du désespoir. Et pourtant, tous
les travailieurs sociaux vous diront qu'en dehors de quelques récidivistes,
la grande majorité des filles-mères sont de fort honnêtes
gens. "Les filles de vie, se hâtent-ils d'expliquer, savent les
moyens à prendre pour éviter l'enfant." De plus, nombre de
filles-mères se plaignent du travail qu'on leur donne à faire
dans les grands hôpitaux d'accueil. Ont-elles raison ? Il
est bien difficile de le savoir. "Trop de travail" est une notion bien
subjective. Les autorités des hôpitaux en question vous
expliquent au contraire que le travail est mesuré selon les forces,
la résistance et les aptitudes de chacune, qu'on tient compte de
l'état de grossesse des pensionnaires.
Mais pour qui connaît par ailleurs le régime de travail dans
tous nos hôpitaux, il n'est pas étonnant d'entendre les
filles-mères se plaindre des tâches qui leur sont
confiées. Nous verrons plus loin, en parlant des crèches,
le régime inhumain que doivent s'imposer religieuses et
infirmières. Celles-ci le font par dévouement. Elles
ont choisi ce travail. Elles ne se trouvent pas elles-mêmes en
période de crise comme la fille-mère qui entre à
l'hôpital dans le quatrième mois de sa grossesse, avec là
perspective d'y demeurer claustrée jusqu'à la naissance de
son enfant.
EN
SCYLLA...
Pour toutes ces raisons d'inégale valeur, et d'autres encore sans
aucun doute, beaucoup de filles-mères refusent l'aide officielle des
hôpitaux spécialisés. En quête d'une
discrétion plus étanche ou d'un milieu plus confortable, elles
frappent à la porte de l'hôpital privé : "Toute
discrétion. plaçons bébé."
Et ce faisant, à quelques rares exceptions près, elles tombent
de Charybde en Scylla.
Toute discrétion ? Oui. Peut-être. Le doute n'est
toutefois pas interdit. L'hôpital qui, par chantage, arrache
$300 ou $500 à une pauvre fille pour.des soins qui devraient coûter
$150, ne fait-il pas la preuve d'une conscience professionnelle très
large ? Ne peut-on pas soupçonner qu'on y fera aussi peu de cas de
la discrétion, si jamais l'indiscrétion peut devenir profitable
?
Enfin, les sociétés d'adoption se sont élevées,
avec combien de raison, contre ce "Plaçons bébés" des
textes publicitaires. Je sais des cas où l'hôpital a
réclamé de fortes sommes à la fille-mère pour
ce prétendu placement, après quoi on est allé déposer
le bébé à la crèche où il vit depuis
aux frais du contribuable. Comment qualifier de tels procédés
? On ne trouve que deux mots adéquats: fausses représentations.
Une fois de plus, qui relèvera ces pratiques ? Qui s'en plaindra tout
haut, avec dossier à date et preuves circonstanciées ? La
fille-mère en parlera dans son entourage immédiat, quand la
crise sera passée. Mais les faussaires pavent très bien
qu'elle a tout intérêt à payer sans mot dire; ils tablent
sur la misère de leur patiente et sur la "honte de là famille".
Et c'est ainsi que des jeunes filles fort honnêtes, victimes d'une
passade malheureuse, sortent chaque mois de l'hôpital privé
avec un mauvais souvenir et des dettes pour quelques années...
CONCLUSION
Quant à l'enfant qu'elles mettent au monde, il prend, comme tous les
autres, le chemin de la crèche. Et cette situation se reproduit
dans presque tous les centres urbains de quelque importance.
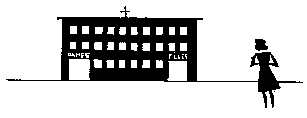
Avons-nous trouvé la manière adéquate de traiter avec
la fille-mère? Disons tout de suite que les un dernières
années ont marqué un progrès très net. Les
hôpitaux sont aujourd'hui dotés de services sociaux qui s'occupent
de la jeune fille pendant toute la durée de son séjour, qui
la suivent même à sa sortie et l'aident à se
réhabiliter. La traite des blanches à la porte des
maternités ne se pratique certainement plus comme autrefois, du moins
pas à la même échelle. Et le séjour dans
des familles, pendant la grossesse, se pratique de plus en plus avec des
résultats nettement positifs.
Mais si le sujet ne débordait pas les cadres de cette enquête,
nous aimerions dire les conditions idéales de l'hospitalisation des
filles-mères. Deux orientations au moins semblent imposées
par les faits il nous faut des établissements plus petits et moins
officiellement étiquetés comme refuges pour
pécheresses...
LA PINGRERIE SORDIDE DU QUÉBEC
Le cas des mères nécessiteuses --- Nos taux sont les plus bas
au pays
--- $57 par mois pour la ère et 10 enfants ---
Trois enfants ontariens valent seize petits Québécois
---
Une comédie politique
J'ai fait lire tout à l'heure à un ami le titre de cet
article. Il l'a cru emprunté à une brochure des Témoins
de Jéhovah, mais il n'en est rien. On verra, par les faits
cités plus bas, qu'il correspond rigoureusement à la
réalité.
Car si la naissance illégitime s'avère grande pourvoyeuse
des institutions de soutien, il faut reconnaître que la loi provinciale
d'Aide aux mères nécessiteuses lui fait, dans ce domaine, une
rude concurrence.
Je songe, en traçant ces lignes, aux ennemis jurés de l'assistance
publique et de l'action gouvernementale en matière de
secours. Certaines gens bien confortables, à petites rentes ou
à gros revenus, protestent avec constance contre les dépenses
de l'État. C'est leur opinion sans doute, jointe au mépris
de notre gouvernement pour les pauvres, qui explique la situation
présente.
Et je songe aux arguments que nous entendons couramment contre les
pensions. "Les gens attendent tout du gouvernement."
"Les gens ne songent plus à se débrouiller comme
autrefois. Le socialisme leur a fait croire que tout leur était
dû. Nous allons vers la paresse intégrale avec toutes nos
lois dites sociales."
Je voudrais que nous gardions en mémoire tous ces beaux raisonnements
en prenant connaissance des faits qui suivent.
MORT DU PERE
Nous voici dans une famille ouvrière de huit ou dix enfants. (Elles
ne sont pas rares.) Et dans cette famille que nous visitons, un grand malheur
vient d'arriver: la mort du père. Cela non plus n'est pas
rare. J'ai vu ces derniers mois autant de cas qu'il en faut pour remplir
un volume.
Voici donc une maman (35 ans peut-être) seule avec huit enfants dont
l'aîné n'a pas quinze ans. A ce rythme de naissance, inutile
de dire que la famille n'a devant elle pas la moindre économie. Le
salaire du mari suffisait à peine pour régler les factures
courantes. On n'avait même pas de quoi régler annuellement
une prime d'assurance sur la vie.
Et nous sommes, répétons-le, dans une famille ouvrière.
Toute la parenté, tous les amis vivent sur la même marge
étroite du salaire rarement suffisant. Je demande donc aux
théoriciens de la débrouillardise: que va faire cette
maman? Comment peut-elle se passer de l'appui gouvernemental sans
tomber dans la misère la plus noire?
C'est extraordinaire ce qu'une situation bien concrète peut
dégonfler certains arguments de rentiers. Le bourgeois raisonne
toujours à partir de sa propre vie. S'il mourait, lui, il y aurait
son oncle à héritage, ses beaux-parents, son assurance-vie,
la vente de sa maison . . . autre chose, encore, à quoi il ne pense
même pas maintenant.
Mais sur l'horizon gris d'une famille ouvrière, aucune de ces
échappées. La famille est acculée à la
misère noire aussitôt que l'unique revenu, celui du père,
cesse d'arriver. Toute association avec une famille quelconque de la
parenté ne serait qu'une addition, qu'une concentration de misères.
NOTRE LOI
C'est pour cela, sans doute, que toutes les provinces canadiennes ont voté,
chacune à son tour, des lois sur l'Aide aux mères
nécessiteuses. On ne pouvait tout de même pas,
indéfiniment, laisser croupir dans la misère des familles
complètes.
Mais si vous croyez que le Québec, province catholique, province
de familles nombreuses, a battu la marche en cette matière, il faut
malheureusement vous détromper.
J'ai relevé, par simple curiosité historique, la chronologie
de ces législations provinciales. J'ai découvert que notre
province, la deuxième en importance du Canada, se classe au septième
rang pour la promptitude à secourir ses familles indigentes. Les
législations initiales en cette matière ont été
votées dans les différentes provinces aux dates suivantes:
Manitoba : 1916
Saskatchewan : 1917
Alberta : 1919
Colombie : 1920
Ontario : 1920
Nouvelle-Ecosse : 1930
Québec : 1937
Nouveau-Brunswick : 1943
Ile du P.-E. : 1949
Nous n'avons donc été battus, sur le terrain de l'incurie,
que par les deux provinces les plus pauvres du pays. Et si nous examinons
maintenant la teneur de chacune de ces lois, nous découvrons qu'en
pingrerie, nous détenons un record absolu. Seuls les chiffres
pour Terre-Neuve manquent encore à notre dossier, je me réserve
de corriger plus tard s'il y a lieu.
Mais des neuf provinces territoriales du pays, c'est la nôtre, la plus
"familiale" de toutes, qui sert aux mères nécessiteuses les
pitances les plus ridicules.
TAUX
Je n'entreprendrai pas ici une revue complète de tous les taux payés
à travers le Canada. Une telle énumération risque
trop d'être fastidieuse. Ayant affirmé que les taux du
Québec sont les plus bas, il me suffira de les comparer maintenant
avec ceux d'une province plus pauvre et ceux d'une province plus riche que
la nôtre.
Dans le Québec, une mère est reconnue nécessiteuse si
elle a perdu son mari, si ce dernier est hospitalisé dans un asile
d'aliénés, dans un sanatorium de tuberculeux, s'il est devenu
invalide ou s'il a déserté le foyer. Ces critères
d'éligibilité sont d'ailleurs reproduits à peu près
textuellement des législations précédentes votées
dans les autres provinces. Ils ne varient guère d'un bout à
l'autre du pays, si ce n'est en matière de propriétés
autorisées.
Chez nous, la mère n'est plus éligible si elle possède
plus de $3,000 dollars en immeubles ou biens d'usage domestique et $1,000
en valeurs liquides, alors que la maman ontarienne peut posséder $4,000
et $1,000 tout en restant éligible.
Mais là où les grandes différences se font sentir, c'est
sur le taux même des secours accordés.
Le maximum payable en Québec pour une mère et un seul enfant
est de $30 dans les localités de moins de 5,000 âmes, et
$35 dans les localités plus importantes. Puis, selon le nombre
des enfants qui restent à sa charge, l'échelle s'établit
comme suit,
Mère et 2 enfants : $36 par mois
- 3 - $37
- 4 - $38
- 5 - $39
- 6 - $41
- 7 - $43
- 8 - $46
- 9 - $49
- 10 - $52
De plus, au cas où cette fortune due à la
générosité de la province risquerait de trop enrichir
la mère nécessiteuse, il lui est interdit de se procurer, par
son propre travail, plus de $25 dollars par mois. Si elle en gagne $26
ou $30, elle perd sa pension.
Les chiffres sont donc très clairs: pour éduquer, loger, nourrir
et habiller une famille de dix enfants, la maman québécoise
en soutien n'a pas le droit de toucher plus de $77 dollars par mois, soit
$19.25 par semaine. Et cela, si la maman trouve le temps de travailler (on
sait que 10 enfants laissent beaucoup de loisirs). Si par hasard la
maman ne pouvait pas travailler, la province lui offrirait un dédommagement
royal de $5 (sic) par mois. Ce qui porterait l'allocation totale à
$57 dollars par mois.
N'importe quel imbécile peut vous dire que ces taux maximums ne couvriront
même pas les factures d'épicerie. Mais notre gouvernement
ne l'a pas encore saisi. Il compte sur les allocations familiales pour
défrayer le reste.
Ne l'a-t-il pas prouvé? Notons-le en effet. Quand le
gouvernement fédéral a voté les allocations, la mère
recevrait $5 dollars par mois pour chaque enfant, au titre de mère
nécessiteuse. Mais naturellement, le gouvernement a raisonné
que la prébende fédérale en plus fournirait à
la mère un revenu exageré; c'est pourquoi il a réduit
l'allocation par enfant à $1 dollar, et reporté sur la pension
de la mère elle-méme (taux fixe) les sommes ainsi
"ménagées".
Puis, comme on ne doit pas liésiter à faire de la politique
à même la misère des pauvres, M. Duplessis
a établi, à compter du sixième enfant, un "taux
croissant" que les allocations ne donnaient pas, de $2 dollars par mois pour
le sixième et le septième, de $3 dollars pour chacun des autres
enfants.
Et le tour était joué. Si cela ne s'appelle pas de la
pingrerie sordide, il faut reviser les définitions du dictionnaire.
AILLEURS ?
En Ontario? La même famille de dix enfants recevra $140 dollars
par mois plus une allocation de chauffage et une autre allocation de $10
dollars est prévue pour des cas spéciaux. C'est
presque le triple des taux québécois. (1)
Mais l'Ontario est riche, diront les sceptiques, plus riche que le Québec.
Examinons alors le cas de la Saskatchewan, dont le burget provincial ne fait
pas la moitié du nôtre. Une famille de 10 enfants y recevrait
$75 dollars, et la mère est autorisée à des revenus
personnels jusqu'à concurrence de $45 dollars par mois.
Cependant, l'Ontario et la Saskatchewan touchent tout aussi bien que le
Québec les allocations familiales.
Mais ils n'ont pas l'avantage d'une politique "nationale, sociale".
Il est donc facile de comprendre que tous nos orphelinats soient remplis
à craquer. Car si la maman garde avec elle son deuxième,
troisième ou dixième enfant, I'État ne lui viendra en
aide que misérablement, à raison d'un dollar, de deux dollars
ou de trois dollars par mois. Si au contraire elle se sépare
de son enfant et le confie à une institution, le gouvernement
dépensera pour cet enfant $21 dollars par mois s'il est placé
dans un orphelinat ordinaire, $27 dollars par mois s'il est placé
dans un orphelinat spécialisé.
N'est-ce pas là une façon détournée, indirecte
mais très efficace de disloquer les familles? Quelle veuve, quelle
épouse séparée voudra garder des enfants à
partager sa misère, quand elle peut leur trouver un abri et une
éducation convenable au prix de l'éloignement?
Et c'est ainsi que notre province, par sa honteuse pingrerie,
écartèle les familles et joue une comédie sans nom d'aide
aux miséreux.
____
(1) Pour toucher l'allocation ontarienne d'une famille de 3 enfants,
soit $70 dollars, il faut que la mère québécoise ait
16 enfants à sa charge.

La suite
|
_____ |
